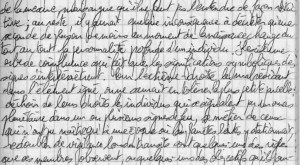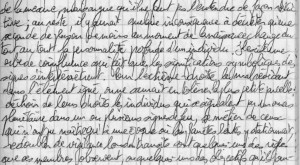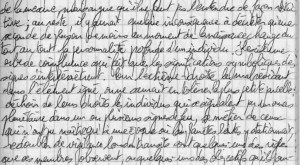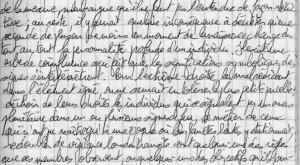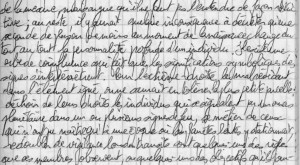Un peu plus tôt ce mois, le 3 juillet pour être précis, je suis intervenu au colloque de l’Association française d’économie politique. Le titre de ma communication semblera obscur au profane. Pourtant, les questions abordées y sont des plus essentielles et épineuses. Il s’agit du passage de la frontière entre l’économie des décisions individuelles, la microéconomie, et celle des grands équilibres nationaux, la macroéconomie. Beaucoup de gens, et la plupart des libéraux avec eux, raisonnent spontanément comme si le raisonnement valable pour quelques individus valait aussi pour l’économie dans son ensemble, et de pointer du doigt tel chômeur qui truande la Secu, tel entrepreneur accablé d’impôts et taxes ou telles complications légales en matière de droit du travail qui seraient autant de freins à l’embauche. À supposer que cela soit vrai au niveau individuel, cela l’est-il au niveau collectif ? En d’autres termes, est-ce que l’économie nationale résulte d’une addition de décisions individuelles ou bien les lois qui la gouvernent obéissent-elles à une autre logique ? Les raisonnements spontanés de la majorité sont du premier type (l’économie dans son ensemble n’est autre chose que l’addition des différentes décisions individuelles qui la constituent, si bien que les analyses valables au niveau des agents le restent au niveau national). C’est donc là tout l’enjeu, entre autres, de mon intervention : nos points de vue naturels sur l’économie sont-ils corrects ? Éléments de réponse.
Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès de ceux que le caractère lapidaire parfois, inachevé souvent, des réflexions que je vais proposer pourrait heurter. Cette communication n’a d’autre ambition que d’établir un pont avec vous, de poser un jalon sur la voie d’un programme de recherche collectif futur, bref d’avancer des arguments prétextes à une réflexion en commun. Beaucoup de ce que je vais dire sera critiquable et j’espère bien que cela sera critiqué si l’exercice permet d’y voir plus clair et de stimuler la gestation de nouvelles théories. Les réflexions qui vont suivre constituent un work in progress.
Pour ceux qui ont le goût de la métaphore, on pourrait affirmer que l’articulation micro-macro est un peu le chaînon manquant de l’analyse économique. Elle n’est, souvent, guère examinée, à tel point qu’un microéconomiste et un macroéconomiste parlent rarement le même langage même quand ils affectent de parler d’un sujet identique. S’il est orthodoxe, le second annulera le niveau micro par une hypothèse d’agent représentatif ou d’anticipations rationnelles conduisant à une domestication probabiliste de l’incertitude. Ou bien il fera tout dériver de comportements individuels dans le cadre d’un ABM dans une pure logique agrégative. S’il est hétérodoxe, il s’occupera avant tout des grands équilibres sur la base d’hypothèses comportementales simples laissant de côté l’hétérogénéité des agents. Quant à eux, les microéconomistes orthodoxes se sont enfermés pour la plupart dans un superbe isolement face à la macroéconomie, la question ayant été résolue en quelque sorte une fois pour toute par la posture de l’individualisme méthodologique pour laquelle les comportements individuels sont à la base de la macroéconomie. Tout rares qu’ils soient, les microéconomistes hétérodoxes ont souvent mis en avant la nature sociale, c’est-à-dire d’emblée macro, desdits comportements, les explications individuelles faisant la part belle au rôle des conventions et autres normes collectives. Dans l’affaire, soit c’est la macroéconomie qui se retrouve mutilée, soit c’est la microéconomie, comme si les deux paradigmes concurrents ne pouvaient penser adéquatement l’articulation des deux niveaux nécessaires de l’analyse économique. De fait, la question de l’articulation de l’analyse micro à l’analyse macro s’est souvent résumée à un affrontement entre partisans des bases micro de la macro et défenseurs des bases macro de la micro (e.g. Kregel, 1987). Les premiers versaient généralement dans l’individualisme méthodologique, les seconds dans l’holisme.
Pour bien saisir la nature du débat entre individualisme et holisme, il s’avère nécessaire de comprendre d’abord ce qu’il n’est pas. La querelle méthodologique s’embrouille souvent d’une présentation biaisée toujours vraie et se voit parasitée par une controverse annexe, avec laquelle on la confond souvent, quoiqu’elle n’ait pas grand chose à voir. Le débat individualisme-holisme n’est pas deux choses.
1. Une présentation trop rusée et trop peu utile de l’individualisme méthodologique a cours légal dans un certain nombre d’ouvrages écrits par des chercheurs très respectables (cf. notamment Boudon, 2003, 2005). À l’en croire, tout phénomène macro serait la résultante non intentionnelle de décisions micro intentionnelles. L’exemple paradigmatique est celui de la queue devant un magasin : personne ne l’a voulue, pourtant elle surgit bien de l’addition d’une multitude de décisions individuelles. Cette position est souvent associée au libéralisme politique, sociologique et économique. Ironie de l’histoire des idées, elle rejoint en quelque sorte Marx, pour lequel si les hommes (micro) font l’histoire (macro), ils ne savent pas l’histoire qu’ils font. Cette posture est d’ordinaire couplée à une autre, qui fait du holisme une doctrine soutenant qu’un collectif, quel qu’il soit (institution, entreprise, etc.), est doté de ses fins ou de ses comportements propres (cf. e.g. Thévenot et al., 2006). Il nous semble que ces définitions jumelles sont trop peu utiles car elles sont toujours vraies. Un poppérien dirait : irréfutables. L’économie est faite pour et par les hommes. Sans activité humaine, elle n’existerait pas. Un holiste ne soutiendra jamais que le cerveau humain n’est pas le siège de l’action. Il n’y a production et échange de marchandises et services que parce qu’il y a toute une chaîne de décisions humaines. Enlevez la décision, qu’elle soit routinière ou sociale n’est alors pas la question, et vous n’aurez aucune production ni aucun échange. Même quand elle dépend de phénomènes naturels, l’économie implique une décision humaine. L’air que nous respirons tous les jours ne fait pas partie du giron de l’économie, car il n’implique aucune intervention humaine. Dès lors qu’on le retraite pour en faire une marchandise, il y a économie. C’est bien l’activité humaine qui est à la source. Au reste, je ne sache pas que quelqu’un puisse soutenir une affirmation aussi absurde que « un collectif est doté de ses fins propres », même assorti d’une clause « tout se passe comme si ». C’est que, en fait, ce débat est trop couvent confondu avec un autre, qui voit s’opposer le libre-arbitre au déterminisme ou, pour le dire de manière plus philosophique, le mécanisme, ou détermination par les causes, et le finalisme, ou détermination par les raisons, si bien que les holistes sont alors accusés par leurs détracteurs d’être mécanistes.
2. Je voudrais rapidement dire ici que le débat individualisme-holisme n’est pas et ne doit pas être celui du mécanisme et du finalisme. Je me contenterai d’ébaucher rapidement l’argumentation, que je développerai plus avant plus tard. Fréquemment, les conventions sociales sont perçues comme des causes, ce qu’elles ne sont pas (de Lara, 2007). Elles déterminent la structure de préférence, mais c’est bien l’individu qui agit. Une convention explique une préférence ou une action, mais elle n’aboutit à un comportement que parce qu’un individu la met en œuvre, se décide conformément à elle. Une convention fait alors partie du répertoire de raisons de l’individu. Elle n’est pas une cause. Ce que vise en fait la critique individualiste méthodologique est le fait que la convention échappe à la prise consciente de l’agent. Pour qu’une convention devienne une cause, il faudrait que, malgré la prise de conscience que l’individu a de ce qui le détermine, il ne puisse infléchir la course de ses actions, sur le mode d’une sorte de paradoxe de Moore (« je sais que j’agis à l’encontre de mes objectifs, mais je ne peux m’empêcher d’agir ainsi »). Par où le débat rejoint celui du libre-arbitre. La conscience est la pierre philosophale qui aide à transmuer la cause en raison. Dès que l’agent est capable d’agir dans un sens différent de la convention mais qu’il opte en connaissance de cause pour elle, elle cesse d’être une cause pour se muer en raison. On voit bien ici, la question que nous nous posons n’est pas susceptible d’une traduction dans ces termes. Mieux (ou pire) : l’envisager selon le couple finalisme-mécanisme engage sur des sentiers trompeurs et conduit à prendre des vessies philosophiques pour des lanternes méthodologiques.
Car ce dont il est question, en fait, est la traversée de la frontière entre raisonnement micro et raisonnement macro. À quel coût s’opère-t-elle ? Quels contrôles sont nécessaires ? À cet égard, l’alternative mécanisme-finalisme pèse peu : que les agents obéissent à des raisons ou non ne rend pas le passage de la frontière plus transparent ou plus fluide. Cela n’aide pas nécessairement à comprendre la nature de cette traversée et peut favoriser la méprise. La seule question pertinente doit se formuler en ces termes : la macro résulte-t-elle d’une simple agrégation des comportements micro (individualisme) ou bien le tout peut-il différer de la somme des parties (holisme) ? Le cas échéant, pourquoi ? Après tout, quand nous avons écarté la première fausse définition, nous avons bien souligné que ce sont les décisions individuelles qui font l’économie et qu’il ne saurait y avoir économie sans elles. On serait alors naturellement porté à croire que nous campons sur une position résolument individualiste. Rien ne serait plus erroné. Reprendre tout uniment la logique agrégative simple reviendrait à s’en tirer à trop bon compte car elle incite à éviter de penser aux raisons d’un écart éventuel entre l’échelle macro et l’addition des niveaux micro. En faire une posture a priori conduit à mutiler l’entendement. À tout le moins, si l’on doit y adhérer, cela ne peut qu’être l’aboutissement d’une longue réflexion sur l’existence possible de phénomènes entraînant un tel écart. Notre proposition est en fait différente : il est des marchés ou des activités relevant d’une logique individualiste, d’autres qui ressortissent à une logique holiste. Raisonner en général ne peut qu’obscurcir le problème. Il nous faut mener notre investigation marché par marché, activité par activité, afin de déceler, ou non, les raisons d’un hiatus possible entre micro et macro.
Tout au long, notre analyse sera hantée par un spectre, celui de ces deux définitions trompeuses. Nous n’en avons donc pas fini avec elles. Pour y voir plus clair, il nous faudra y revenir quand la situation l’exige.
1. Géopolitique de l’holisme
Notre analyse liminaire nous amène inévitablement à l’interrogation : pourquoi le tout pourrait-il différer de la somme des parties ? Après tout, un compte en banque résulte bien de l’addition des sommes versées et de la soustraction des montants retirés. La comptabilité d’entreprise, elle-même, est par essence agrégative. L’individualisme méthodologique pourrait sembler roi. À tout le moins, il pourrait sembler naturel ou de règle. Une première analogie peut nous être fournie par la thermodynamique. D’après Prigogine, elle aurait détruit l’équivalence entre phénomènes micro et macro là où la mécanique quantique « classique » reposait encore sur la réversibilité du temps et l’agrégation : les phénomènes macro suivent des lois probabilistes qui ne se peuvent déduire de l’examen micro (Prigogine, 1996 ; cf., également, Gleick, 1987). Si l’on est apte à suivre la trajectoire d’un nuage de gaz, on ne peut en déduire la position individuelle de chaque particule. Seul l’ensemble est sujet à un aléa stochastique ; si le niveau micro est également susceptible d’explication, on ne peut sauter d’un niveau à l’autre, et cela, bien qu’un nuage ne soit pas composé d’autre chose que de particules. On pourrait être tenté de croire qu’il existe des phénomènes similaires en économie. Nous ne nous engagerons pas sur cette pente, potentiellement très glissante, en particulier en raison de la prévalence de faits et de causalités si complexes qu’elles ne semblent pas susceptibles d’une traduction en termes probabilistes. Notre analogie était purement didactique ; elle visait à souligner que dans d’autres domaines de connaissance aussi existaient des phénomènes holistes et qu’un point de vue non individualiste n’est sans doute pas aussi étrange qu’il puisse paraître spontanément. Le sens peut émerger à un autre niveau. Sans même faire appel aux complexités labyrinthiques de la thermodynamique, on peut reprendre à notre compte l’exemple traditionnel du rire : nous sommes bien formés d’atomes ; pourtant, quand l’hilarité nous saisit, nous ne sommes pas formés d’atomes rieurs. Le rire émerge à une autre échelle. On voit bien l’analogie. Les entreprises sont les atomes de l’économie. Pour autant, quand l’économie attrape un rhume, cela ne signifie pas qu’une majorité d’entreprises a pris froid ; inversement, lorsqu’elles éternuent, cela n’implique pas nécessairement que l’économie va mal (tout dépend du phénomène considéré).
Mais entrons dans le vif du sujet et proposons trois causes possibles de tracasseries à la frontière entre raisonnement micro et raisonnement macro : effet de composition, jeu à somme instable et détermination marginale. Il va être difficile d’expliquer notre typologie sans exemples. Aussi prions-nous par avance notre lecteur de faire preuve de mansuétude à notre endroit quand viendra le moment de faire un tour d’horizons des divers marchés, c’est-à-dire le moment des redites, à la troisième section.
L’effet de composition
L’effet de composition est le plus connu des keynésiens. En ces temps d’austérité, il est aussi le plus évident. Il dérive tout entier de la nature double de tout acte d’échange au sens large. Tel Janus, il présente deux faces : pour l’un, l’acheteur, il constitue un coût, pour l’autre, le vendeur, il forme un revenu. Si l’on se contentait d’additionner simplement les décisions des uns et des autres, on se condamnerait à la confusion. Le tout ne peut résulter de l’agrégation des décisions des acheteurs ou des vendeurs, quoiqu’un marché n’existe pas en dehors des acheteurs et des vendeurs. Une mesure politique particulièrement favorable pour les acheteurs aura toutes les chances de ne pas l’être pour les vendeurs du fait de cette symétrie : baisser les coûts des premiers signifie nécessairement diminuer les revenus des seconds. En règle générale, le gain des uns est la perte des autres. Et quand nous écrivons « coût » ou « revenu », il ne faut pas comprendre « prix unitaire » mais bien « prix total » (c’est-à-dire « prix unitaire » multiplié par les quantités échangées). Le sophisme de composition est connu de longue date des keynésiens qui mettaient en exergue l’inanité des raisonnements ceteris paribus sur le marché du travail, comme si l’emploi macro résultait de l’addition des décisions d’embauche individuelles des entrepreneurs. Ce qui est récupéré sur le coût du travail est, dans une moindre mesure en raison d’effets de cliquets, perdu au niveau du chiffre d’affaires, car un coût aux yeux de l’employeur est un revenu aux yeux du consommateur-salarié, si bien qu’une baisse du revenu disponible se traduit par une chute de la consommation, cet autre nom du chiffre d’affaires.
Il existe donc, au plan macro, des interactions entre les phénomènes micro qui rendent difficile d’en extraire une conclusion. En tout état de cause, ces interactions interdisent d’en faire une simple agrégation des décisions micro. On pourrait arguer que, en toute rigueur, ce type de phénomènes relève encore de l’individualisme méthodologique : la vente au niveau macro résulte bien de l’addition de tous les comportements de vente et l’achat de la somme des comportements d’achats. Si les 10 entreprises d’un secteur d’activité dépensent chacune 1 million d’euros pour une marchandise donnée, l’achat global est égal à 10 millions d’euros. Le sophisme de composition vise en fait le raisonnement ceteris paribus, ce que l’individualisme méthodologiquement rigoureusement pensé n’est pas. Une analyse d’équilibre partiel sur le marché du travail, comme si l’offre d’emploi était la conséquence de la seule aversion aux coûts d’entrepreneurs néoclassiques, est de ce point de vue fautive car elle néglige les effets de retour. Cela n’empêche pas les équilibres généraux d’obéir à une logique agrégative. L’analyse précédente était fautive car elle oubliait que, dans le même temps (symétriquement, si l’on préfère), les comportements globaux d’achats (de marchandises produites par les employeurs) résultent également de l’addition d’une multitude de décisions : en réduisant le pouvoir d’achat de chacun des consommateurs (ou de la majorité d’entre eux), on diminue bien les montants totaux qui sont dépensés et, partant, on fait se rétrécir l’argent à la disposition des employeurs, qui ne peuvent alors plus se préoccuper de la seule variable des coûts (du travail). Aux yeux d’un individualiste méthodologique intelligent, nul doute que le sophisme de composition ne vaudra qu’en tant que rappel à la vigilance : il faut tenir en haute méfiance le raisonnement ceteris paribus et prendre en compte tous les effets retour possible. Il convient ici de remarquer que notre première définition trompeuse du débat n’invite pas à ce genre d’exercice de lucidité. Les effets de composition tombent effectivement sous le coup des résultats non intentionnels de décisions intentionnelles. Elle n’aide en rien et peut même induire en erreur si elle conduit à se focaliser sur le seul plan micro.
Avec les effets de composition, le tout est bien égal à la somme des parties correctement définies. Mais le fait d’attirer l’attention sur leur existence en leur dédiant une des catégories de notre typologie a des vertus méthodologiques. Trop souvent, le raisonnement des défenseurs de l’individualisme est mené sur un seul marché, sans prise en compte des interactions, comme si le seul niveau d’analyse qui importait vraiment était le niveau micro. Si, au sens strict, les effets de composition ne relèvent pas du holisme, ils tendent à plaider sa cause : grâce à eux, on pourra se concentrer également sur l’autre face de toute transaction afin de déceler les éventuels effets retour.
Le jeu à somme inégale
Le jeu à somme inégale peut indifféremment être appelé l’inexistence macro d’un phénomène purement micro. Quoique les individus puissent mener un raisonnement particulier au niveau micro, il n’a aucune validité macro ; ou alors, s’il a des effets macro, ceux-ci ne sont pas le décalque, « en grand », des décisions micro. La liquidité en est l’exemple par excellence. Keynes souligne à plusieurs reprise dans le chapitre 12 de la Théorie générale qu’il n’existe rien de tel, pour l’économie dans son entier, que la liquidité, bien que cela soit un motif individuel prégnant. D’ailleurs, il affuble régulièrement le terme même de liquidité de guillemets (six fois) en vue de souligner combien il met en doute son existence comme phénomène macro, quand bien même il s’agirait d’un comportement indéniable au plan micro. S’il existe quelque chose comme une demande de monnaie à l’échelle macro, il n’y a rien qui ressemble à de la liquidité. Quand il dénonce « le fétichisme de la liquidité », Keynes appuie : « il n’est rien de tel qu’un investissement liquide pour la communauté dans son ensemble » (notre traduction). En effet, dans une transaction, la liquidité de l’un implique l’illiquidité de l’autre. On pourrait croire que nous nous trouvons dans une situation voisine de celle des effets de composition dus à la nature double des transactions. Sauf que, ici, les frontières mêmes de la liquidité sont mouvantes. D’où le terme de « somme inégale ». À l’extrême limite, seuls les pièces et billets sont assurés de représenter la liquidité voire, en cas de crise politique et sociale majeure, ceux-ci peuvent trouver des substituts (cigarettes, œufs, formes diverses de troc, etc.). La liquidité est une notion purement micro. Elle est ce qui apaise l’inquiétude de l’investisseur et le pousse à prendre plus de risques ou à ne plus en prendre du tout. Indifféremment position de repli dans un contexte de crise de confiance généralisée ou assurance contre l’incertitude d’un investissement encourageant à la dépense, elle est d’une redoutable volatilité. Quoiqu’elle dépende de facteurs macro, la liquidité est d’abord une caractéristique micro d’un investissement donné. Elle est affaire de degrés : un bien est plus ou moins liquide. Elle est pour partie réelle (le temps de mise en vente d’un bien, de rencontre du contrepartiste…), pour partie conventionnelle. À ce titre, elle est également une croyance collective. Si tous les opérateurs la recherchent, celle-ci s’effondre. C’est pourquoi elle n’obéit pas à une logique agrégative. Plus les comportements individuels sont motivés par la liquidité, plus les frontières macro de ce qu’est la liquidité se rétractent. Plus les comportements visent la liquidité, moins ils peuvent l’obtenir. En temps normal, la majorité des positions sont relativement illiquides. C’est un jeu à somme négative fluctuante. Le motif de liquidité implique alors qu’un contrepartiste accepte d’être moins liquide pour qu’un autre le soit plus. C’est pourquoi la notion ne peut être valide pour la communauté dans son ensemble. La chose est encore plus vraie en temps de crise, quand les contrepartistes se font rares et que les transactions sont bloquées. Certes, elle porte nécessairement l’empreinte d’une confiance collective en l’avenir, mais qu’elle soit influencée par une variable macro n’entraîne pas qu’elle fasse sens à ce niveau.
Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’un tel comportement s’emballe, situation désignée par « le fétichisme de la liquidité » voué aux gémonies par Keynes, il y a des répercussions macro, mais elles ne sont pas celles visées par les individus. Jusqu’au point de bascule, les opérateurs parviennent à leurs fins ; ceux qui voulaient être liquides le sont. Pourtant, l’économie dans son ensemble aurait même tendance à l’être moins ; les catastrophes futures se préparent à l’ombre des clameurs générales. Il est ainsi deux raisons plaidant la cause du holisme : la nature double de toute transaction ; les frontières mouvantes de la liquidité. La première implique qu’au plan macro la liquidité reste inchangée, puisqu’un contrepartiste accepte d’être moins liquide en échange de la plus grande liquidité de son partenaire. La seconde implique un déplacement des lignes, puisque la recherche éperdue de liquidité provoque la chute générale de la liquidité. Là où la première met en jeu une symétrie annulant au plan macro un comportement micro, la seconde renvoie à un effet pervers. Le jeu n’a pas de somme stable. Même dans les périodes d’absence d’effet pervers, la situation méthodologique n’est pas celle des effets de composition. En aucune circonstance la position des deux contrepartistes peut se révéler plus liquide ; au plus haut de l’euphorie, toute liquide qu’elle soit, une action l’est moins que du cash. Il y a nécessairement symétrie. Une position plus liquide (dans notre exemple, la vente de l’action) se traduit forcément par une position moins liquide (i.e. l’achat de l’action) au plan macro, quoique ce titre financier, objet de l’échange, puisse être plus liquide qu’auparavant (les opérateurs s’avèrent plus enclins à s’en porter acquéreurs, d’où la rapidité de la transaction et le fait qu’elle s’opère à une valeur sinon certaine du moins favorable). Dans l’effet de composition, le motif de réduction de coûts peut par exemple avoir un impact macro. Les gains de productivité qui en résultent éventuellement sont susceptibles, adéquatement répartis, de se traduire par une embauche et une élévation du chiffre d’affaires via la hausse des salaires. Une baisse du coût du travail n’est pas forcément annulée par une diminution équivalente du chiffre d’affaires. Dans le cas d’un jeu à somme inégale – le « inégale » étant ici à prendre au sens de « inégale d’une période à l’autre » – l’annulation est systématique.
Quand on considère l’analyse macro, le comportement micro n’a pas disparu, il cesse simplement d’être pertinent. Ce qui est susceptible d’exister à ce niveau là est le fétichisme de la liquidité, qui engendre un effondrement des transactions. Mais, outre que ces situations ne représentent pas, heureusement, l’ordinaire des marché, l’effet macro n’est pas celui voulu au plan micro, pas plus qu’elles ne résultent d’une addition des comportements. Si elles sont bien une conséquence de décisions individuelles, elles provoquent des effets macro pervers qui, à leur tour, ont des répercussions micro. La somme des parties ne fait pas de sens. Il n’y a pas de logique agrégative.
La détermination marginale
Nous en venons maintenant au phénomène le plus holiste, auquel j’ai réservé l’appellation, peut-être pas des plus heureuses, de « détermination marginale ». Dans le cas précédent, on pouvait encore parler de somme des parties. Ici, le terme disparaît. Une décision ou une attitude micro n’ont, la plupart du temps, aucun impact macro. Le fétichisme de la liquidité indiquait la possibilité d’une conséquence non intentionnelle d’une action intentionnelle. Il n’y a rien de tel ici, sauf à la marge. Les comportements micro n’ont pas d’incidence macro. Ce qui fait sens à une échelle donnée, cesse de le faire dès qu’on change d’échelle.
Prenons un exemple parlant. L’arbitrage revenu-loisir des offreurs de travail sur le marché du même nom. Un grand nombre d’élucubrations économétriques excipent de l’indéniable désutilité du travail et de son corollaire, la latitude d’effort dans la recherche d’emploi, pour « démontrer » les effets néfastes de l’Etat-providence. En clair : les allocations-chômage dissuaderaient la reprise d’un emploi. Que les demandeurs d’emploi mettent plus ou moins d’ardeur dans leur recherche ne fait pas de doute. Au niveau micro, il y a bien variation de l’effort individuel. Naturellement, plus la durée d’indemnisation est longue, moins, toutes choses égales par ailleurs, les agents sont enclins à accepter un emploi. Au niveau macro, cette variation d’effort a peu de chances d’avoir la moindre implication. En effet, l’offre d’emploi préexiste à l’effort du chômeur et n’est pas liée à lui. S’il y a 22 millions de postes pour 25 millions de demandeurs d’emploi, il y aura nécessairement 3 millions de chômeurs, quelles que soient les motivations des uns et des autres. Même si les 25 millions d’offreurs de travail se montraient très enthousiastes et donnaient à chaque fois le meilleur d’eux-mêmes dans leur quête, il y aurait toujours 3 millions de chômeurs. Agréger les comportements micro des chômeurs revient à introduire en contrebande l’hypothèse farfelue que c’est la volonté de dégoter un job qui crée ce poste. Pour que la décision micro influe sur le niveau macro du chômage, il faudrait qu’existent des offres d’emploi pour lesquelles aucun chômeur motivé ne postule. Et encore se heurterait-on à un problème d’extraction de signal, car la cause de cette absence pourrait très bien être à chercher du côté de l’attractivité du poste (conditions de travail et de rémunération, etc.) plutôt que de celui de la motivation des candidats. C’est pourquoi nous avons baptisé ce type de phénomène de « détermination marginale » : s’il exerce le moindre effet macro, ce dont on peut douter, il ne l’exerce qu’à la marge. Bien que valable au plan micro, l’arbitrage revenu-loisir dû à la désutilité du travail cher aux néoclassiques, n’est en général pas susceptible d’avoir la moindre implication macro. Il n’en aurait qu’en cas de rigidité ou d’imperfection du marché du travail massive et d’une espèce bien particulière : les employeurs refusent d’accroître l’attractivité du poste en conséquence d’une pénurie de travailleurs motivés. Par là, deux conditions sont cumulées, à savoir 1) une pénurie très importante de candidats motivés ; 2) le refus/l’impossibilité d’élever l’attractivité des emplois dans les secteurs affectés par cette pénurie. Obvions incidemment à un malentendu courant dans la presse. Qu’il existe à un instant t un stock d’emplois non pourvus ne dit rien sur l’attitude des chômeurs, ni même sur l’adéquation de leurs compétences aux postes disponibles. En effet, recruter demande du temps. On peut avoir un poste non pourvu le 6 avril et avoir trouvé quelqu’un le lendemain ou à la fin du mois. Les variations, au fil des trimestres, de ces stocks peuvent en revanche être significatives. Mais il n’est pas dit qu’il faille y voir l’indice d’une moindre motivation des demandeurs d’emploi, puisqu’il existe beaucoup de raisons possibles, comme une plus grande sélectivité des employeurs.
Signalons, afin d’obvier à tout malentendu, que les travaux économétriques d’économie du travail dont nous avons connaissance n’invoquent à aucun moment une quelconque loi de Say (e.g. Crépon & Desplatz, 2001 ; Cahuc & Zylberberg, 2005, 2008 ; L’Horty et al., 2009). Ils se contentent d’agréger les fonctions de décisions individuelles, la demande macro étant vue comme simple « perturbation stochastique ». Ils méconnaissent donc, par construction, ces phénomènes de détermination marginale.
|
|
Effets de composition
|
Jeu à somme inégale
|
Détermination marginale
|
|
Phénomènes en cause
|
raisonnement ceteris paribus
interactions/interdépendances
|
Symétrie
Effets pervers
|
Insignifiance macro, sauf à la marge
|
|
Exemple paradigmatique
|
Coût du travail
|
Liquidité
|
Offre de travail
|
Tableau 1. Typologie des causes possibles de holisme
Notre typologie a été classée par ordre croissant d’holisme. Les effets de composition le sont ou faiblement ou pas du tout, selon que l’on prend bien en compte ou non la nature double des transactions ainsi que les effets retour possibles. À tout le moins, les faire entrer dans la catégorie de l’holisme méthodologique offre l’avantage d’attirer l’attention sur les interactions et les interdépendances en jeu. C’est ici le raisonnement ceteris paribus, à quoi nous invite l’individualisme mal compris, qui est fautif. Les jeux à somme inégale le sont fortement, pour des raisons qui tiennent à l’annulation macro par symétrie et à l’existence d’effets pervers. Quant à la détermination marginale, elle l’est presque intégralement. Comme son nom l’indique, elle n’est gouvernée par l’individualisme méthodologique qu’à la marge. Des conditions bien spécifiques doivent être réunies afin que l’on puisse considérer que les comportements individuels influent sur le niveau macro de certaines variables.
2. Le rôle des conventions dans le débat
Mais que diable peuvent venir faire les conventions dans cette galère ? Dans la typologie proposée, elles n’apparaissent spécifiquement nulle part. Nos trois catégories peuvent être ou ne pas être conventionnelles, cela ne change rien à leur traduction méthodologique. C’est qu’une convention a beau être macro par définition, elle ne peut pas être autre chose que l’agrégation de structures de perception et de décision cognitives individuelles. Qu’une convention préexiste à l’individu du fait de l’histoire n’a de ce point de vue pas d’importance. Elle ne peut agir en dehors des agents économiques : il faut donc que ces derniers y adhèrent, consciemment ou pas. Rappelons que notre réflexion est d’ordre méthodologique et non pas éthique ou politique. Pourtant, ce sont souvent des raisons de ce dernier type qui embrouillent les débats méthodologiques ; il ne s’agit pas de savoir si les individus sont libres, mais si les règles de fonctionnement macro de l’économie résultent d’une agrégation des comportements micro. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que l’école dite des conventions se réclame de l’individualisme méthodologique (Orléan, 1994 ; Thévenot et al., 2006).
Le caractère holiste ou non d’un phénomène macroéconomique ne lui vient pas de son aspect conventionnel ou non. Pour bien le comprendre, penchons-nous sur les différentes définitions qu’en peuvent donner l’école des conventions et la sociologie d’inspiration bourdieusienne. Suivons André Orléan. Il affirme ceci : « La notion de convention […] désigne une régularité de comportement R au sein d’une population P telle que : (1) tous les membres de la population se conforment à R ; (2) chacun croit que tous les autres membres de P se conforment à R et (3) trouve dans cette croyance une bonne et décisive raison pour se conformer à R ; (4) par ailleurs, au moins, une autre régularité R’ vérifiant les conditions précédentes aurait pu prévaloir » (Orléan, 1994, p. 12). Remarquons que cette définition se veut descriptive. Elle dit ce que font les agents, pas ce qu’ils devraient faire. Pour les sociologues de quelque obédience qu’ils soient, les conditions 1 et 2 sont sans aucun doute beaucoup trop restrictives. Un Richard Hoggart définissait les classes sociales non par ce que les individus font, mais par une croyance collective normative (Hoggart, 1957). Une convention est ainsi ce que les membres d’une classe sociale pensent que les autres membres devraient faire ou penser. C’est plutôt la croyance en la légitimité d’une convention, plus que le comportement issu de cette convention, qui la définit. Pour Pierre Bourdieu (e.g. Bourdieu, 1980, 1997), l’analyse sociologique est statistique ; elle ne délimite jamais de groupes au sein desquels absolument tous les membres suivent une même règle ou observent un même comportement. Elle est chez lui d’ordre à la fois descriptif et normatif. Elle désigne une régularité dans les façons de percevoir, juger et se comporter comme une règle structurant ces mêmes perceptions, jugements et comportements. La convention n’acquiert sa pleine efficacité que parce qu’elle est incorporée sous forme d’habitus, qui fonctionne le plus souvent sans accéder à la représentation explicite. Elle ne définit pas précisément, une fois pour toutes, le contenu de ce qu’il faut penser et décider, car elle comporte, en son cœur même, une part de flou et d’indétermination. (Bourdieu, qui était un grand lecteur de Wittgenstein, comme d’ailleurs de Hoggart, reprenait à son compte sa critique de la notion de règle. Donc quand nous écrivons « règle » plus haut, il ne faut pas l’entendre dans un sens rigide. Bourdieu aime à répéter que les agents improvisent ; il emploie fréquemment la métaphore du « sens pratique » comme équivalent d’habitus.) Il s’ensuit que l’irréalisme des conditions 1 et 2 ne s’impose pas. Retraduits en termes sociologiques, ces conditions donnent : 1) une proportion considérable f de membres d’une population p se conforme à r et/ou s’imagine devoir se conformer à r ; 2) chaque agent de f croit que tous les autres membres de p devraient se conformer à r. Cette définition des conventions étant statistique, on en déduit qu’elles relèvent d’une logique agrégative, partant de l’individualisme méthodologique.
Officiellement, la posture de l’école des conventions renvoie dos à dos partisans de l’individualisme et du holisme (cf. Postel, 2003 ; Thévenot et al., 2006) et plaide pour un « cadre d’individualisme méthodologique élargi » (Orléan, 1994b, p. 53) voire « renouvelé » (Postel, 2003, p. 211). Cependant, il s’avère que cet individualisme new look diffère au fond peu de l’ancien ; à tout le moins il n’en diffère pas d’un point de vue méthodologique. En effet, que les théories de cette école permettent d’expliquer les relations non marchandes (Postel, 2003), de penser la coordination via les valeurs (Boltanski & Thévenot, 1991) ou repose sur une vision plus souple de la rationalité (Bessis et al., 2006 ; Livet & Thévenot, 1994) n’a rien à voir avec une quelconque articulation des bases macro de la micro aux bases micro de la macro. La question est et demeure : l’échelle macro est-elle plus que l’agrégation des différentes échelles micro ou : le tout est-il autre chose que la somme des parties ? Sur ce point crucial qui nous occupe, l’école des conventions se range résolument du côté individualiste classique et n’a pas de réponse originale à proposer, quelle que soit la fécondité de ses analyses par ailleurs.
Plus tard, André Orléan est revenu sur sa définition des conventions afin d’en adopter une vue statistique (Orléan, 2002). Les croyances sociales ne sont pas de type i1 (« un grand nombre de personnes croient à la proposition P ») mais de type i2 (« un grand nombre de personnes croient que le groupe croit à la proposition P »). « Le collectif trouve à s’expliquer d’abord par le collectif, et non l’individuel » (Orléan, 2002, p. 722), l’économie pouvant s’établir dans une situation où tous les agents croient individuellement P tout en étant convaincus que le groupe croit Q : la macro n’est, de fait, pas l’agrégation des conjectures micro. Il emprunte l’exemple des cambistes qui peuvent croire une monnaie sous-évaluée et être persuadés que le marché – i.e. l’euro – va encore baisser. Ce faisant, il nous semble qu’André Orléan a mélangé deux anticipations différentes, celle, économique, d’entreprise, et celle, psychologique, de spéculation. Dans le chapitre 12 de la Théorie générale, Keynes désigne par le terme d’« entreprise » l’anticipation visant à estimer la rentabilité de long terme d’un investissement et par « spéculation » l’anticipation visant à estimer sa rentabilité à très court terme afin d’en extraire une plus-value. On peut donc sans incohérence aucune croire une monnaie sous-évaluée selon un critère d’entreprise et surévaluée selon un critère de spéculation. Il n’y a là pas la moindre contradiction ; il s’agit simplement de deux types différents d’évaluations. Une situation où les agents croient individuellement P tout en étant convaincus que le groupe croit Q n’est ainsi pas possible, car la croyance collective est nécessairement statistique, donc individualiste méthodologique.
La meilleure acception méthodologique des conventions nous semble présenter des similitudes fortes avec celles du vote ou du sondage. Une élection consiste bien en une addition de voix. Par excellence individualiste, elle nous aide à saisir la nature des croyances collectives. Bien sûr, au sein de l’opinion dite publique entendue au sens non de l’opinion rendue publique des élites mais de l’opinion du public il est des voix qui pèsent plus que d’autres (Champagne, 1990). Pas toutes les opinions ne se valent. La force sociale ou la puissance de persuasion des uns et des autres vient déformer l’égalité de l’arène démocratique. Pour autant, l’opinion publique n’en cesse pas moins de résulter de l’agrégation des croyances individuelles : l’inégalité dont il est question n’est autre chose que le nombre de ralliements ou de conversions à son point de vue. Si par malheur quelqu’un échoue à persuader, il ne pèsera pas plus qu’un autre. Quelle que soit la définition qu’on lui donne, une convention est par nature individualiste méthodologique. Une idée isolée devient convention par le nombre ; c’est là une condition nécessaire quoiqu’un insuffisante. Que des conditions de durée et de légitimité s’y ajoutent n’altère pas le cadre méthodologique, car le nombre constitue toujours sa condition suspensive primordiale : sitôt qu’il reflue, la convention perd de sa force.
Son rôle engage en fait un autre débat, qui n’est pas le nôtre. Les conventions, phénomène macro à base micro, forment également un phénomène micro à base macro puisqu’elle renseigne les individus sur ce qu’ils doivent penser et faire. « En tant qu’êtres humains, nous sommes contraints d’agir. La paix et le confort de l’esprit nécessitent que nous nous cachions à nous-mêmes l’étendue de notre ignorance. Pourtant, nous avons besoin d’être guidés par quelque hypothèse. Nous tendons de fait à substituer au savoir hors de portée certaines conventions » (Keynes, 1987, p. 124). Le rapport des conventions à la décision individuelle est un tantinet circulaire, avec un léger avantage macro : les conventions déterminent pour partie la structure des préférences, à l’origine de l’utilité des alternatives ouvertes au choix (Schoemaker, 1982) ; l’existence des conventions suppose l’adhésion d’une grande masse d’individus au sein d’un groupe donné (pas nécessairement la majorité) ; dès lors qu’il a pleinement conscience d’une convention, un individu peut choisir dans une certaine mesure de ne pas la suivre. Toutefois, des conventions sont léguées par l’histoire ; la société avec ses règles et ses interdits, ses sens uniques et ses priorités, existait avant que les individus ne viennent au monde et ne deviennent des agents économiques. En ce sens, il y a un léger avantage de la convention. Cependant, ce sont bien les individus qui font évoluer les conventions et en font émerger de nouvelles, quoique ce ne soit pas de façon ex-nihilo. Même la créativité n’est pas sans règles. Le débat concerne l’endogénéisation des préférences : d’où viennent nos façons de penser et de décider ? Quelle est la nature de nos anticipations ? L’analyse des conventions, voie d’entrée privilégiée de la sociologie dans la théorie économique, nous renseigne sur 1) les objectifs des agents, 2) leurs biais cognitifs. Elle ne change pas la méthodologie des phénomènes macroéconomiques. Une convention est statistique. À ce titre, elle résulte bien de l’addition des croyances individuelles, quelle que soit leur origine. Il s’agit donc de ne pas se tromper de débat.
3. Tour d’horizon des phénomènes individualistes et des phénomènes holistes
Au préalable, il convient de bien distinguer entre la constitution d’un agrégat tel que, par exemple, la demande macro de monnaie, et les déterminants micro de cet agrégat, i.e. les motifs de détention de monnaie. Un agrégat numérique résulte toujours de l’addition de ses multiples composantes. La demande de monnaie macro est constitué par l’ensemble des demandes micro ; le nombre d’emplois offerts (i.e. le résultat de la demande de travail) résulte de l’addition des emplois offerts par chaque entreprise. Là où le holisme peut s’infiltrer, c’est quand on raisonne à partir des déterminants micro de ces composantes : les motifs de détention macro, le tout, est-il plus que la somme des motifs micro ? La demande de travail macro, le tout, est-elle plus que l’addition des demandes de travail micro ? etc. C’est le raisonnement du modélisateur qui nous intéresse : comment et à quelles conditions dériver une courbe d’offre et de demande macro à partir de courbes d’offre et de demande micro ? Le débat ne concerne pas la comptabilité nationale, où un montant macro résulte par définition d’une addition de montants micro, mais la modélisation, où il s’agit d’expliquer et prévoir. Dans un cas on ne s’occupe que des résultats, dans l’autre on s’intéresse aux déterminants.
Nous venons de proposer que toute convention est individualiste. Quels sont les autres phénomènes ou marchés qui ressortissent de cette nature méthodologique ? En tant que comportement collectif, la demande effective semble en relever. Elle consiste en une addition d’anticipations individuelles (Asimakopulos, 1991). Leur objet est mi-macro mi-micro, ou plutôt micro à travers des lunettes macro, puisqu’il s’agit d’évaluer la demande particulière adressée aux entreprises, laquelle dépend de facteurs éminemment macro (budget des ménages, évolution des goûts des consommateurs, conjoncture internationale, taux d’intérêt, etc.). Le fait que Keynes n’ait pas évoqué les erreurs d’anticipations de court terme à propos de la demande effective ne signifie pas qu’il les excluait de l’analyse ; il voulait simplement attirer l’attention sur l’importance des anticipations des entrepreneurs : la demande n’agit pas directement mais à travers elles (Ibid.). La demande effective est macro et statistique ; à ce titre, les divergences individuelles se dispersent autour de la moyenne. On comprend mieux pourquoi Keynes n’a pas insisté sur les erreurs micro, puisque ce sont les anticipations agrégées qui importent. De toutes les façons, la constatation d’un écart entre l’anticipation et la réalité donne lieu à une nouvelle anticipation et c’est toujours l’anticipation qui fait la demande effective.
Sur le marché du travail, l’offre est soumise, nous l’avons vu, à des phénomènes de détermination marginale. Quant à la demande, elle subit des effets de composition.
Sur les marchés financiers, l’individualisme méthodologique est de règle. La demande et l’offre résultent bien de l’addition de leurs parties constitutives. La demande de monnaie pour motifs de transaction et de précaution semble être gouvernée par une logique purement agrégative. Mais, comme nous l’avons souligné plus haut, les comportements de liquidité, donc ceux de spéculation, obéissent à un jeu à somme inégale. La liquidité n’a pas de signification macro, quoiqu’elle en ait au plan micro.
En ce qui concerne l’investissement productif, l’individualisme paraît également de mise. L’agrégat de l’investissement résulte bien de l’addition des différentes décisions individuelles. On peut toutefois suspecter la présence d’effets de composition. Comme l’a signalé à de nombreuses reprises Asimakopulos (Asimakopulos, 1978, 1991), les dépenses courantes d’investissement influent sur le niveau macroéconomique de la croissance et, par là, sur le chiffre d’affaires micro et les perspectives de rendement futur. Nous sommes en présence d’une forme de prophétie auto-réalisante qui rend difficile le raisonnement ceteris paribus. Les entrepreneurs doivent prendre garde à inclure l’impact prévisible ex-post de leur décision sur leur estimation ex-ante. Cette réserve n’a peut-être pas beaucoup d’importance en cas d’atomicité, mais elle en a dans le cas contraire. Toutefois, il s’agit là d’une objection de bon sens, et l’on peut gager que les entrepreneurs intelligents prendront en compte dans leurs anticipations les répercussions de leurs décisions. Quid des incitations à investir ? Toutes choses égales par ailleurs, l’aiguillon du profit et de la fiscalité excitent les ardeurs et l’imagination, mais justement la clause ceteris paribus est des plus fragiles : si cela conduit à élever la fiscalité des consommateurs ou à diminuer les salaires, principale composante de la consommation, les perspectives de rendement futur vont s’assombrir. On aura alors perdu d’une main ce que l’on aura récupéré de l’autre. Des effets de composition très puissants semblent en jeu.
L’endettement semble relever du jeu à somme inégale. La symétrie est parfaite puisque l’endettement de l’un, le débiteur, a pour condition l’enrichissement de l’autre, le créditeur. Au niveau macro, l’endettement global ne fait pas de sens, sinon dans une réflexion générale sur le patrimoine ou les stocks de richesse. Comme pour la liquidité, il peut y avoir des effets pervers : la course effrénée à l’endettement, sans souci du lendemain, est susceptible de provoquer la méfiance des bailleurs de fonds et in fine, leur refus de prêter à nouveau ou à des taux prohibitifs. L’endettement des agents n’est dépourvu d’effets macro, mais ce n’est pas l’effet recherché ; en cas d’insolvabilité ou de défaut de paiement, il y a redistribution de ressources et érosion de la confiance.
Résumons nos développements par le tableau suivant :
|
Décision micro
|
Passage de la frontière micro-macro
|
|
Demande effective
|
Individualisme
|
|
Demande de monnaie pour motifs de précaution et de transaction
|
Individualisme
|
|
Liquidité/motif de spéculation
|
Jeu à somme inégale
|
|
Endettement
|
Jeu à somme inégale
|
|
Investissements productifs
|
Effets de composition
|
|
Demande de travail
|
Effets de composition
|
|
Offre de travail
|
Détermination marginale
|
Tableau 2. Tour d’horizon du passage de la frontière de la décision micro à la variable macro
En termes de modélisation de l’économie, il ne faut donc s’intéresser aux bases micro que dans les cas d’individualisme méthodologique et d’effets de composition. Dans les autres circonstances, elles peuvent être négligées.
Toutes ces variables micro sont agitées en profondeur par les remous de la confiance. Il nous faut donc maintenant nous livrer à un excursus sur le rôle de ce facteur clé de toute économie.
4. La confiance, base des anticipations
Comment la confiance intervient-elle ? Comment la modéliser ?
Pour Dequech, dont nous reprendrons ici la définition, la confiance est la propension à agir sur la base d’une estimation (Dequech, 2003). Pour qu’elle débouche sur une action, une estimation doit passer par le canal de la confiance. Une même évaluation, une même information, recevront donc des traductions décisionnelles différentes. Le cas s’est souvent, trop souvent, vérifié sur les marchés financiers où une déclaration identique des autorités monétaires est susceptible de provoquer des réactions opposées en raison du climat des affaires.
Précisons un peu plus notre définition. Contrairement à une bonne partie de la littérature, nous ne parlerons pas de la confiance dans le seul rapport aux autres ou aux institutions (e.g. Reynaud, 2004 ; Eloi, 2012). Nous suivrons sur ce point Keynes, pour lequel la confiance est un rapport à l’avenir en général. Elle est à la racine émotionnelle d’une anticipation. Les faits, les informations inspirent plus ou moins confiance. Dans son Treatise on Probability, Keynes avait des probabilités une définition philosophique subjectiviste : elles manifestent le degré de confiance dans une conclusion. Or, ces développements ne marquent pas l’époque d’une jeunesse révolue : dans le si crucial chapitre 12 de la Théorie générale, en note de bas de page, la filiation avec sa thèse sur les probabilités est revendiquée haut et fort. La confiance est le degré de vérité subjective d’une anticipation. Plus il est important, plus on se sent en confiance. Elle est le substitut par excellence à une impossible connaissance parfaite. Elle consiste en un mélange d’analyses rationnelles incomplètes dont les trous sont comblés par l’émotion. D’où sa volatilité. La confiance est double : elle est tantôt le sentiment de véracité du présent constaté ou de l’avenir projeté tantôt le sentiment de succès des actions décidées sur la base de ces projections. Elle est l’aliment privilégié des esprits animaux, dont nous avons dit l’importance dans les décisions d’investissement. Moins on dispose d’informations, plus elle est appelée à jouer un rôle majeur. C’est pourquoi elle occupe une telle place dans les décisions d’investissement, productif ou financier. Dans le premier cas, les conséquences des décisions s’étendent dans le futur le plus lointain. Dans le second, il s’agit de prévoir la réaction du public dans une mise en abîme perpétuelle (cf. la métaphore du concours de beauté). Toutefois, on aurait tort de circonscrire son rôle à ces seuls domaines. Car elle peut aussi intervenir dans des décisions plus routinières, comme la demande effective ou les comportements d’offre et de demande de travail. En fait, en tant que soubassement de toute anticipation, on voit mal dans quel champ d’application elle n’interviendrait pas. Sitôt que l’environnement économique, social et/ou politique paraît plus menaçant et incertain, la confiance s’érode. Par contamination, même les décisions les plus usuelles semblent entachées de doute. La surprise s’invite. Le cours ordinaire des décisions est comme suspendu ; une réflexion nouvelle s’y installe, qui montre la fragilité des bases de l’action.
La fluctuation de la confiance s’explique dans ses deux dimensions, collective et individuelle, par le constat d’un écart croissant entre les projections et les réalisations. Mais, une fois propagée et renforcée, elle gagne en profondeur et peut bloquer les décisions sans qu’il soit besoin de remarquer de tels écarts. Les fluctuations de la confiance s’appellent optimisme et pessimisme. De proche en proche, elles altèrent les estimations elles-mêmes. C’est pourquoi nous ne pouvons retenir la définition de Dequech, de laquelle nous sommes partis : la confiance n’est pas seulement la propension à agir sur la base d’une estimation donnée mais aussi la propension à évaluer favorablement les informations à notre disposition dans le cadre de nos évaluations. Pour autant, il faut bien se garder d’en faire un synonyme d’estimation. La confiance fournit le socle de nos estimations, mais il reste encore à ériger murs porteurs et poutres maîtresses. Nous l’avons signalé, elle n’est pas seulement à la racine émotionnelle de nos anticipations, elle en est aussi le fruit. Nous avons plus ou moins confiance dans nos décisions. Elle est la mesure de la prévisibilité du futur à nos yeux. Elle ne nous dit pas quels éléments intégrer afin d’évaluer un taux de rendement ni comment les intégrer (c’est en cela qu’elle diffère d’une estimation en soi), elle nous dit le poids de ses éléments, leur fiabilité.
Elle est profondément hétérogène. Ce qui inspire confiance à l’un n’inspire pas nécessairement confiance à l’autre. À ce titre, elle dépend des différentes personnalités des agents économiques. Dans ce qui suscite et érode la confiance, certaines informations ont plus de poids que d’autres. La personnalité agit comme filtre et accusateur/atténuateur (elle accuse certains traits ou en atténue la saillance). Sur les marchés financiers par exemple, certains opérateurs se focaliseront plus sur les déclarations de la BCE, d’autres plus sur les chiffres du commerce chinois, d’autres encore sur l’immobilier, etc. En termes de modélisation, la confiance est ce facteur qui convertit une information en action via une évaluation. Elle n’agit pas sur les objectifs, mais, en fonction de ces objectifs, elle affecte tout d’un certain coefficient. C’est comme cela, sans doute, que nous pouvons l’interpréter : un coefficient qui coiffe l’ensemble du modèle. Mais ce coefficient lui-même varie en fonction de la personnalité. Notre intuition est qu’il n’y a pas autant de types de confiance qu’il y a d’individus. Notre thèse vise, entre autres, à dresser une typologie des types de confiance regroupant les agents économiques selon certaines caractéristiques de leurs personnalités importantes en vue de la modélisation. Si l’hétérogénéité peut se traduire, mettons, par sept ou huit façons de réagir à l’incertitude afin d’en tirer une plus ou moins grande confiance, alors la modélisation nous semble possible.
Il y a des effets de seuil. En cas de crise de confiance, il faut beaucoup d’informations favorables pour renverser la vapeur. Inversement, en période d’euphorie, seule une accumulation importante d’éléments défavorables est de nature à susciter la crainte. Ces effets de seuil devront faire l’objet d’études empiriques en vue de leur modélisation.
Conclusion très provisoire
Quoique ce soient toujours les décisions des agents économiques qui soient à l’origine des phénomènes économiques, pour certains d’entre eux, le sens émerge à un autre niveau. Notre typologie des causes possibles d’holisme visait à tenter de clarifier la situation. Elle vaut invitation à considérer très précautionneusement les paramètres micro à inclure dans sa modélisation. Notamment, il s’avère que les comportements en matière de liquidité et d’endettement n’ont pas les impacts macro visés au niveau micro. En temps normal, elles n’ont pas d’incidence mais elles peuvent subitement en revêtir (fuite vers la liquidité, insolvabilité, crise du crédit, etc.). Sans doute peut-on les traiter comme sans influence, sauf une fois franchi un certain seuil.
La réflexion à ce sujet pourra sembler encore par trop embryonnaire. Nous ne sommes pas en mesure de proposer des solutions toutes faites de modélisation à partir de notre typologie. Le rôle précis de la confiance demande des études empiriques plus poussées. Les analyses méthodologiques constituent un préalable indispensable à toute tentative de modélisation. Aussi prions-nous le lecteur de nous excuser de n’avoir pas livré d’examen de tel ou tel modèle. Notre propos se voulait général. Notre espoir est de continuer, dans le futur, à poser quelques jalons sur cette longue route qui mène à une modélisation satisfaisante.
Références
Asimakopulos A., 1978, “Keynesian Economics, Equilibrium and Time”, Canadian Journal of Economics, 11, 4.
Asimakopulos A., 1991, Keynes’s General Theory and Accumulation, Cambridge University Press.
Bessis F. et al., 2006, « L’Identité sociale de l’homo conventionalis », in Eymard-Duvernay et al. (dir.), Economie des conventions, méthodes et résultats, La Découverte.
Boltanski P. & L. Thévenot, 1991, De la justification, Gallimard.
Boudon R., 2003, Raison, Bonnes Raisons, PUF.
Boudon R., 2005, Le Sens des valeurs, PUF.
Bourdieu P., 1980, Le Sens pratique, Editions de Minuit.
Bourdieu P., 1997, Méditations pascaliennes, Le Seuil.
Cahuc P. et A. Zylberberg, 2005, Le Chômage, fatalité ou nécessité ?, Flammarion.
Cahuc P. et A. Zylberberg, 2008, Les Réformes ratées du président Sarkozy, Flammarion.
Champagne P., 1990, Faire l’opinion, Paris : Editions de Minuit.
Crepon B. et R. Desplatz, 2001, « Une nouvelles évaluation des effets des effets des allègements de charges sociales sur les bas salaires », Economie et statistique, 348.
De Lara P., 2007, « À quoi sert la distinction des causes et des raisons ? », in Leçons de philosophie économique, Alain Leroux & Pierre Livet (dir.), Economica, tome III.
Dequech D., 2003, “Conventional and Unconventional Behavior under Uncertainty”, Journal of Post-Keynesian Economics.
Eloi L., 2012, Economie de la confiance, La Découverte.
Gleick J., 1987, Chaos, Vintage Books.
Hoggart R., 1957, The Uses of Literacy, Transaction Publishers (trad. française : La Culture du pauvre, Minuit, 1975).
Kregel J., 1987, “Rational Spirits and the Post Keynesian Macro Theory of Macroeconomics”, De Economist, 135, 4.
Livet P. & L. Thévenot, 1994, « Les catégories de l’action collective », in André Orléan (dir.), L’Analyse économique des conventions, PUF.
Keynes J., 1973, A Treatise on Probability, McMillan.
Keynes J., 1987, Collected Writings, XIV, Defense and Development, McMillan.
Keynes J., 1998, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Payot.
L’Horty Y. et al., 2009, « Les effets des allègements de cotisations sociales sur l’emploi et les salaires : une évaluation de la réforme de 2003 », Economie et statistique, 429-430.
Orléan A., 1994a, « L’économie des conventions : définitions et résultats », in André Orléan (dir.), L’Analyse économique des conventions, PUF.
Orléan A., 1994b, « Des marchés aux organisations : survol de la théorie économique contemporaine », in André Orléan (dir.), L’Analyse économique des conventions, PUF.
Orléan A., 2002, « Le tournant cognitif en économie », Revue d’économie politique, 112.
Postel N., 2003, Les Règles dans la pensée économique contemporaine, CNRS Editions.
Prigogine I., 1996, La Fin des certitudes, Odile Jacob.
Reynaud B., 1994, Les Règles économiques et leurs usages, Odile Jacob.
Schoemaker P., 1982, “The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations”, Journal of Economic Literature, 20, 2.
Thévenot L. et al., 2006, « Valeurs, coordination et rationalité : trois thèmes mis en relation par l’économie des conventions » in Eymard-Duvernay et al. (dir.), Economie des conventions, méthodes et résultats, La Découverte.